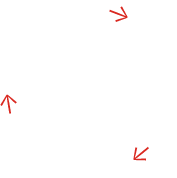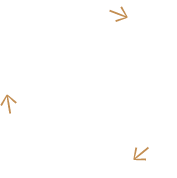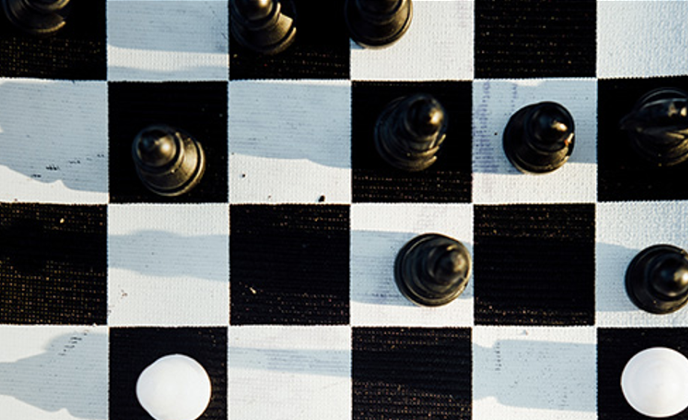Nevouségarezpas
avecunestratégiefloueetfigéequimanquerasacible


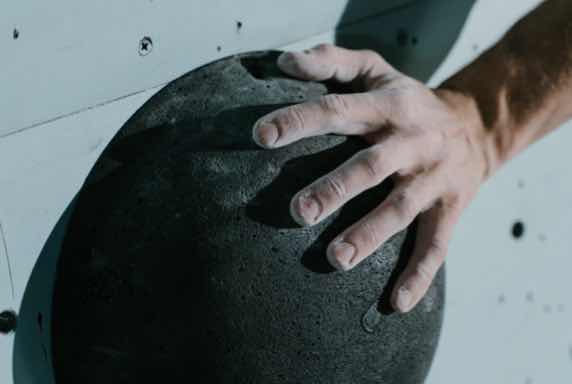


Près de 70% des stratégies élaborées ne sont jamais implémentées ! Résultat ? Désengagement des équipes, décisions peu claires, travail en silo et opportunités manquées.
Pourtant, dans un espace stratégique qui change constamment, agir sans prévoir n'est pas non plus la bonne solution
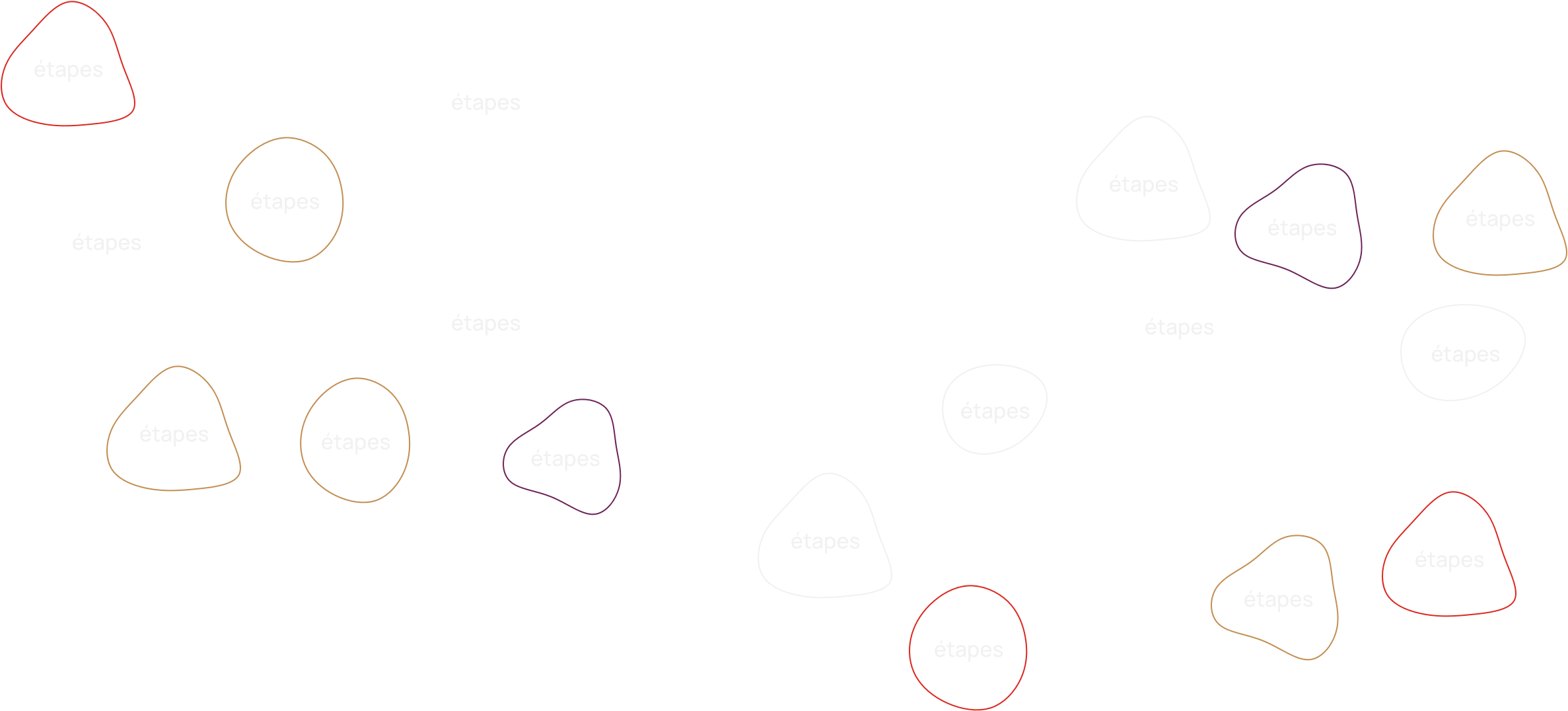
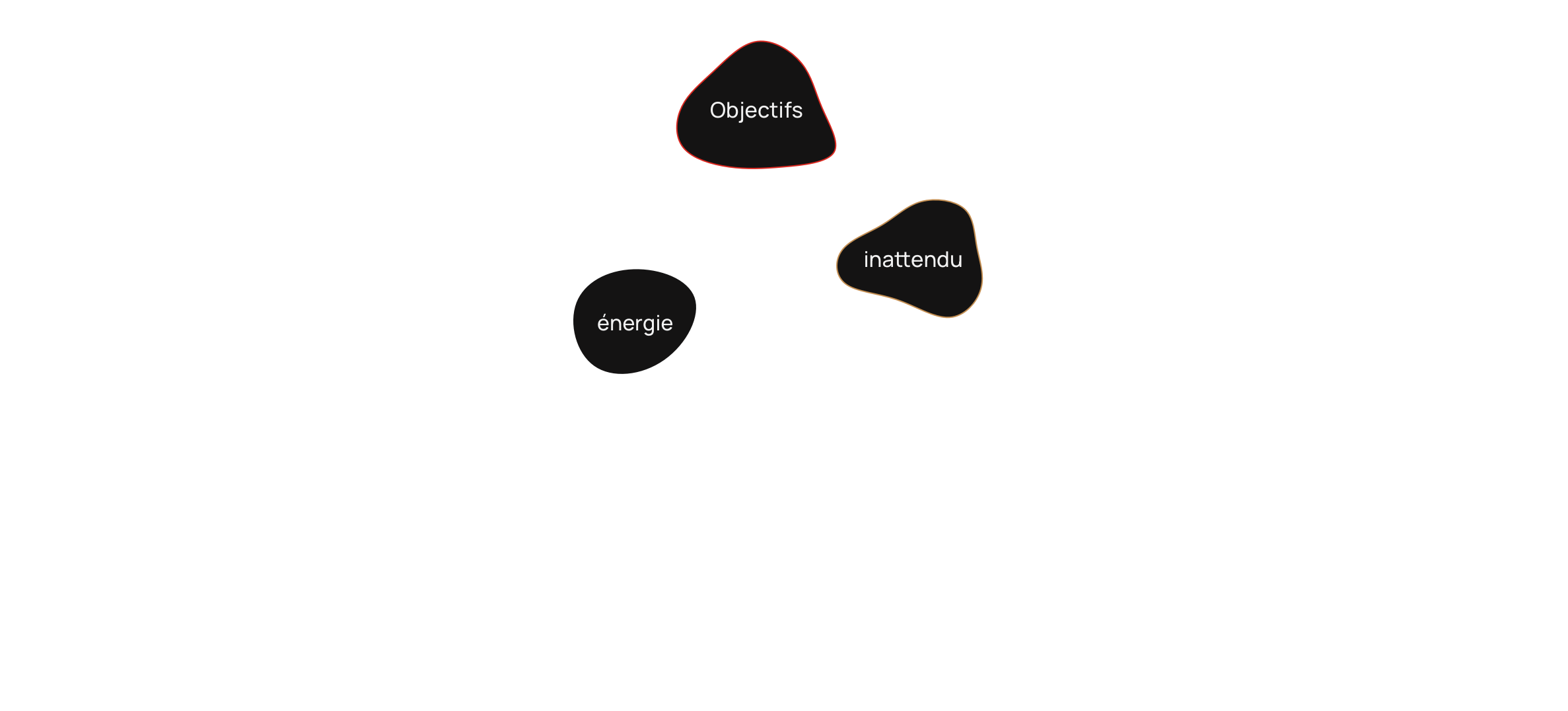
RENDEZ VOTRE STRATÉGIE FORTE & FLEXIBLE !
- Établissez une vision claire et mobilisatrice
- Ne dispersez pas vos efforts et choisissez vos combats
- Sachez réadapter en continu votre trajectoire
Fixezlecap
etpréparez-vous
àl'inattendu


Clarté des objectifs
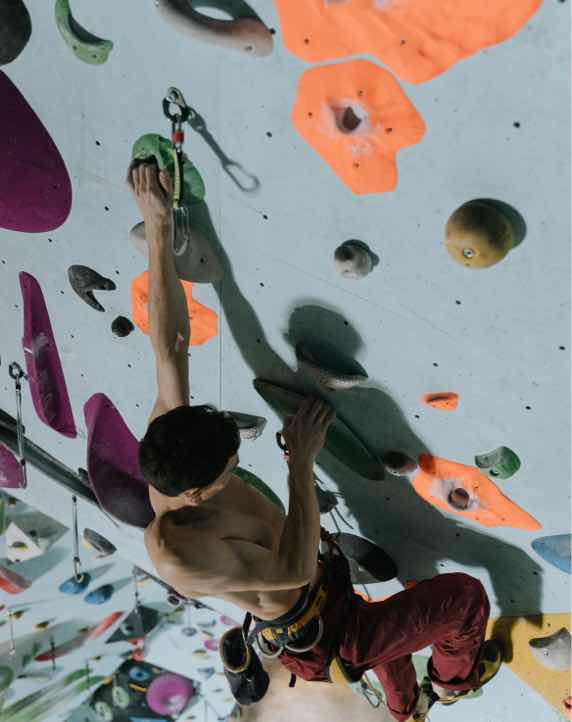

Efficacité de la roadmap


Agilité du pilotage
Notre valeur
ajoutée
Votre vision est claire
01.
Votre roadmap est efficace
02.
Votre stratégie est réussie
03.
La planification stratégique
By Ad Valoris
Guide de la stratégie d'entreprise : définition, types et défis
SI CE N’EST PAS DÉJÀ FAIT, ÉLABOREZ VOTRE STRATÉGIE
Une stratégie claire vous donne l’avantage concurrentiel,
aligne vos équipes
et vous permet de pivoter avec agilité face aux imprévus.
NE PAS EN AVOIR, C’EST NAVIGUER À VUE !
Fixez le cap
et préparez-vous à l’inattendu
pour rendre possible votre success story
Parlons clair !
5 raisons de choisir Stratégie by Ad Valoris
Vous bénéficiez d’une stratégie clairement définie et alignée avec une vision partagée.
Vos équipes sont unies et engagées pour atteindre vos objectifs. Votre stratégie est suffisamment flexible pour s’adapter aux circonstances.
Vous évaluez constamment vos progrès ce qui vous permet d’anticiper les risques, et de profiter des opportunités.
Vous maximisez l’impact des ressources impliquées.
Vous transformez en résultats la vision que vous poursuivez.


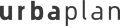



Nos offres sur ce service
Aller plus loin
Prendre les bonnes décisions grâce à la matrice SWOT
Les différentes orientations stratégiques pour une entreprise
Tout savoir sur les différents types d'orientation stratégique....