Titulaire d’un doctorat en informatique, Catherine Pugin a exercé auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, puis au Centre d’évaluation des choix technologiques (TA-SWISS). Elle est aujourd’hui déléguée au numérique du Canton de Vaud, chargée de coordonner la mise en œuvre de la stratégie numérique du Conseil d’État.
Ad Valoris l’interroge sur le dispositif, les objectifs et les jalons qui encadrent cette mission, appelée à évoluer au rythme des innovations technologiques qui transforment nos sociétés.
En 2018, le Conseil d’État vaudois a adopté une stratégie numérique. De quoi s’agit-il exactement ?
Catherine Pugin. Le Canton a été pionnier : il ne s’agissait pas d’un simple plan de « numérisation de l’administration », mais bien d’une vision politique. L’objectif était d’affirmer le rôle de l’État dans la transformation numérique, de maintenir la cohésion sociale tout en restant promoteur d’innovation sur le territoire, et de donner de la cohérence entre les politiques sectorielles (santé, éducation, économie, etc.). Ce document trace un cap plus qu’il n’énumère des actions et des indicateurs.
Vous prenez vos fonctions début 2020… puis survient la pandémie. Cet événement a-t-il bouleversé vos priorités ?
Ce moment de crise a démontré la justesse de l’approche que nous promouvons avec la stratégie numérique : pour continuer à fonctionner, l’administration a dû faire fi du fonctionnement traditionnel en silo et adopter une vision transversale et globale des enjeux. Parallèlement, et sans que ce soit spécifiquement dû à la pandémie, plusieurs projets fédéraux nous ont conduit à mettre l’accent sur la notion de souveraineté cantonale dans l’État fédéral, avec pour priorité de préserver et cultiver notre capacité de choix. J’ai aussi choisi de mettre à l’agenda un sujet alors peu traité : le lien entre transformation numérique et durabilité.
Concrètement, comment avez-vous organisé la gouvernance de cette stratégie ?
Je n’aime pas trop le mot « gouvernance », que je traduis plutôt par « coordination efficace et travail autrement » et qui s’incarne dans trois démarches :
- une collaboration étroite avec le laboratoire d’innovation interne, afin de tester des méthodes de co-conception et de renforcer la collaboration entre services et professionnels ;
- une collaboration avec les différents niveaux institutionnels, notamment grâce à la création, à l’initiative de Vaud et Genève, de la Conférence latine des directrices et directeurs du numérique (CLDN), qui permet de formuler des positions communes et de dialoguer directement avec la Confédération ;
- la transformation de la DSI en Direction générale du numérique et des systèmes d’information, avec une mission élargie : il s’agit désormais de porter la vision du Conseil d’État et d’accompagner l’État et la société dans la transformation numérique.
Comment fixez-vous vos jalons et vos priorités ?
Le Conseil d’État a fixé un cap avec la Stratégie numérique, dans laquelle il articule une vision globale de la transformation numérique et du rôle de l’État. Partant de là, certaines actions et priorités s’imposent d’elles-mêmes. Pour d’autres, c’est un équilibre entre les agendas nationaux (Confédération, communes), qui s’imposent, et les opportunités repérées au sein de l’organisation. La priorisation s’effectue par l’écoute des métiers, la faisabilité et la contribution au cap stratégique fixé par le Conseil d’État.
Pour vous donner un exemple : la cybersécurité a toujours été une priorité pour l’État de Vaud, et cela fait plusieurs décennies que nous investissons dans ce domaine pour les systèmes d’information de l’administration cantonale. Mais lorsqu’une vague de cyberattaques a secoué les communes du Canton en 2021-2022, il est devenu clair que l’État pouvait faire plus pour les accompagner. C’est ce à quoi nous nous attelons depuis : nous avons renforcé le dialogue, signé une convention, et on voit ici comment la transformation numérique implique que l’État puisse répondre de manière agile à des contextes nouveaux.
Je pourrais aussi vous donner l’exemple du numérique responsable : en 2018, on parlait déjà des impacts sociaux mais assez peu de l’impact environnemental du numérique. La stratégie numérique l’évoque mais sans objectif clair. Depuis, on a réalisé que c’est un aspect essentiel, et c’est pourquoi nous en avons fait une priorité, avec l’obtention du label de référence en la matière et un dialogue permanent avec nos partenaires cantonaux et communaux.
Le rapport entre services informatiques et numérique crée parfois des frictions. Comment l’avez-vous abordé ?
Il me semble nécessaire de changer la posture « client-fournisseur ». L’informatique devrait assumer désormais des responsabilités d’orientation, dire parfois « non » si une demande n’est pas alignée avec la vision, et se positionner comme copilote de la transformation.
Protection des données, éthique, influence des plateformes : quelle est votre boussole ?
Au-delà des règles, c’est un enjeu sociétal. Nous misons sur le débat démocratique et sur les compétences critiques des citoyens. La Suisse offre un cadre propice (votations, débats sur l’e-ID, expérience du traçage pendant le Covid). Il faut aussi faire entendre la voix de la science : technologies respectueuses de la vie privée (PET), architectures d’identité, etc., et savoir vulgariser ces sujets.
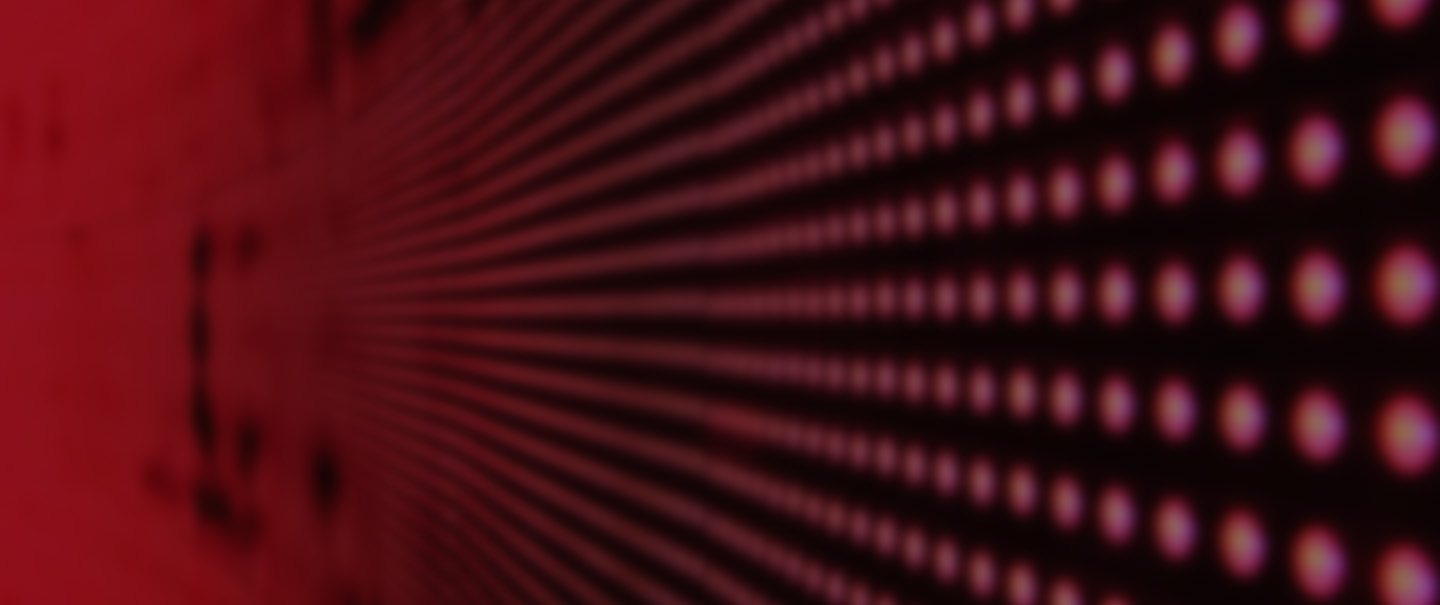
Le Canton a été pionnier : il ne s’agissait pas d’un simple plan de “numérisation de l’administration”, mais bien d’une vision politique.

Que recouvre pour vous la démarche de « numérique responsable » ?
C’est reconnaître l’empreinte réelle du numérique – énergie, matériaux, infrastructures – et revenir à la valeur d’usage : pour quoi, pour qui, comment ? Concrètement : sobriété des services, allongement des cycles d’équipement, priorisation des projets à forte valeur publique, règles d’usage, voire lutte contre l’hyper-connexion. La question centrale reste : quel numérique voulons-nous ?
Comment travaillez-vous avec l’écosystème vaudois (industries, start-up, hautes écoles) ?
Nous avons la chance de posséder un écosystème riche : la Trust Valley (créée en 2020 pour promouvoir l’Arc lémanique comme pôle d’excellence en matière de confiance numérique), divers programmes d’appui, la HES-SO/HEIG-VD, l’UNIL, l’EPFL. Nous entretenons des liens constants : cas d’usage, terrains d’expérimentation, séminaires multi-acteurs. Nous collaborons aussi avec le Swiss Data Science Center et dialoguons sur des modèles de données et d’IA, par exemple avec le projet Apertus.
Comment associer les citoyens et renforcer la confiance ?
Par la transparence et la co-construction : des groupes utilisateurs sont mobilisés (fiscalité, information/communication), appuyés par des méthodes participatives. On observe également certaines collectivités qui explorent les budgets participatifs et, plus largement, tout ce qui renforce la démocratie à l’ère numérique. Les votations sur des objets technologiques, comme l’e-ID, jouent un rôle clé.
À quelle échelle faut-il traiter les sujets d’infrastructure et de souveraineté ?
Vous avez raison de soulever cette question d’échelle. On voit bien qu’il n’est pas possible de régler toutes les questions au niveau cantonal, et qu’il faut travailler autrement. Je vous propose un exemple : le cloud souverain. En 2023, les cantons latins se sont unis pour mettre ce sujet à l’agenda politique : nous avons commandé et publié 3 études de faisabilité et sollicité la Confédération pour avancer dans ce nouveau projet d’infrastructure. À l’échelle cantonale, on donne l’impulsion ; mais il est clair que la solution pertinente doit se dessiner au niveau suisse (par exemple le Swiss Government Cloud), afin de servir cantons, communes et Confédération. C’est parfois la seule manière de faire face aux défis globaux.
IA, blockchain : comment décider du bon tempo ?
Observer, tester, cadrer. L’IA générative s’est imposée par l’usage et devient un sujet politique : éthique, travail, efficience, accès aux droits. La blockchain a connu un pic d’attention, puis un reflux, mais reste structurante là où l’intermédiation est en jeu (identité, paiements, énergie). L’important est de coaliser les acteurs et d’éviter à la fois l’emballement prématuré ou l’entrée tardive.
Quel est votre cap à cinq–dix ans ?
Je me fonde sur trois objectifs
- Maîtriser l’impact du numérique et orienter les ressources vers des usages à forte valeur publique ;
- Réduire les dépendances et renforcer notre autonomie stratégique sur les outils et infrastructures critiques ;
- Faire du fédéralisme une force : multiplier les expérimentations locales, faire remonter les apprentissages et coordonner au niveau national.Et un défi transversal : promouvoir le développement de compétences pour que le numérique soit inclusif.
Très concrètement, où l’IA peut-elle améliorer les services publics ?
Là aussi, je propose trois champs :
- Back office et efficience : rédaction, résumé, extraction d’informations, qualité des données – avec un cadre légal et une gouvernance des données adaptés ;
- Pilotage des politiques publiques : science des données pour comprendre les besoins, évaluer et ajuster les dispositifs ;
- Accessibilité et inclusion : assistants encadrés, interfaces plus inclusives, traduction et simplification administratives.
Pour conclure, que vous inspire l’IA et sa prise de pouvoir sans partage ?
Plutôt que de m’interroger sur sa légitimité ou ses dangers, je rappelle qu’elle ne fonctionne pas sans données. À ce titre, notre responsabilité est d’en organiser un usage sûr et utile. C’est un enjeu de taille, dans un monde où la dérégulation économique semble s’imposer.
Toutefois, je relativiserais cette notion de prise de pouvoir. Il est évident que l’IA a bouleversé et bouleversera beaucoup d’aspects de nos vies, et que dans le futur elle continuera à nous éblouir sur beaucoup d’aspects. Pour l’instant, ce qu’on constate une fois passé le moment d’émerveillement des premières années, c’est que, pour que l’IA apporte de l’efficience et de la valeur dans nos organisations, il y a des prérequis : un personnel formé à son utilisation et à ses risques bien sûr, mais aussi des professionnels qui maîtrisent leur domaine d’activité et sont en mesure de l’utiliser avec un esprit critique. Pour des organisations comme des États ou des entreprises, il y a aussi besoin d’expertises juridiques et informatiques pour répondre aux impératifs de maîtrise des données et de l’information.


« L’objectif était d’affirmer le rôle de l’État dans la transformation numérique, de maintenir la cohésion sociale tout en restant promoteur d’innovation sur le territoire, et de donner de la cohérence entre les politiques sectorielles. »
Catherine Pugin, déléguée au numérique du Canton de Vaud
.
Contactez-nous
Nous écrireSuivez-nous sur Linkedin
SuivreFaites notre quiz : Votre stratégie est-elle déconnectée de la réalité ?
QuizAller plus loin
Ad Valoris s’entretient avec Cédric Petitjean, directeur général de l’office cantonal de l’énergie (OCEN)
Entretien sur une mission appelée à évoluer au rythme des innovations technologiques....




